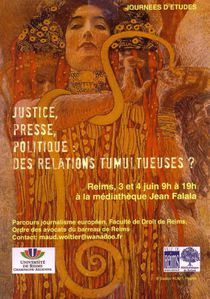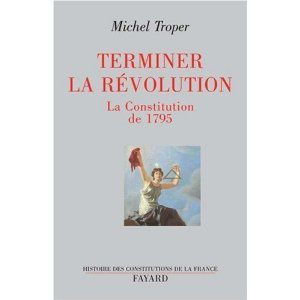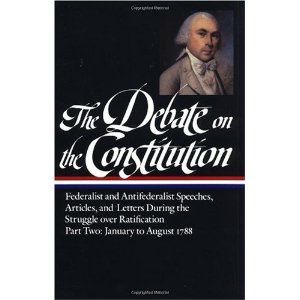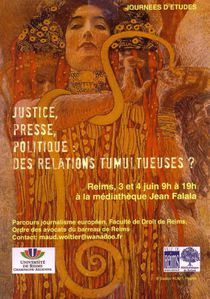
Les 3 et 4 juin 2010 ont eu lieu à Reims des journées d'études sur le thème Justice, Presse et Politique, des relations tumultueuses. Ces rencontres ont été organisées sous l'égide des Facultés de Droit et de Lettres de Reims, avec le concours des étudiants du parcours journalisme européen, et le soutien du Barreau de Reims et de la ville de Reims.
Les débats ont été filmés et sont disponibles sur le site des journées:
http://justicepressepolitique.blogspot.com/
Je suis intervenu lors de la première journée sur un thème historique et juridique: les procès politiques de 1830 et 1849, procès qui illustrent les relations complexes, dès cette époque, entre la justice, la presse (et sa liberté limitée) et l'action politique (marquée par des révolutions répétées et des changements de régime).
Les différentes interventions feront l'objet d'une publication.
extraits:
La dépendance de la justice, les procès politiques de 1830 et 1849.
Le principe d'une justice indépendante se trouve au cœur de nos régimes politiques contemporains ; les réformes successives sont même souvent examinées à l'aune de ce principe fondamental et fondateur. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi.
Durant le XIXe siècle, à la suite des multiples révolutions et changements de régimes intervenus en France, une justice spécifiquement politique a existé. Deux exemples sont significatifs non seulement de sa logique mais également de ses excès : les procès de 1830 et de 1849. Le premier vise les ministres de Charles X poursuivis pour les ordonnances qui ont déclenché la révolution. Il se déroule du 15 au 21 décembre 1830 et concerne quatre accusés : Peyronnet, Chantelauze, Guernon-Ranville et Polignac ; les autres personnes poursuivies s’étant exilées, leur jugement n’est pas intégré à la présente audience. Le second concerne les acteurs socialistes ouvriers et parlementaires des émeutes de mai 1848. Il s’ouvre le 7 mars à Bourges et s’achève le 2 avril 1849. Sont jugés, directement, Courtais, Degré, Larger, Borme, Thomas, Villain, Blanqui, Albert, Barbès, Sobrier, Raspail, Flotte et Quentin, et par contumace Louis Blanc, Seigneuret, Houneau, Caussidière, Laviron et Chancel.
Dans les deux cas, les questions juridiques sont certes traitées, mais, la justice s'apparente beaucoup plus à un instrument du pouvoir, parfois maladroit, qu'à une structure indépendante et juste. Le statut de la presse à cette date n'en fait pas un acteur mais un témoin (potentiellement engagé) ; dans ce cadre, la presse d'opposition et la presse de gouvernement s'affrontent, brouillant un peu plus l'image de la justice mais rappelant aussi les dangers d'une collusion avec le pouvoir en place.
Rendre compte en parallèle de ces deux procès politiques invite dans un premier temps à mettre en exergue les écarts de cette justice particulière au regard du droit applicable (I) ; une telle étude conduit également, dans un second temps, à souligner les relations complexes que les deux instances illustrent entre le pouvoir et l’opinion publique au travers justement d’une procédure juridictionnelle (II).


/image%2F1445356%2F20150613%2Fob_7dc93f_declaration-independence-70222-1.jpg)